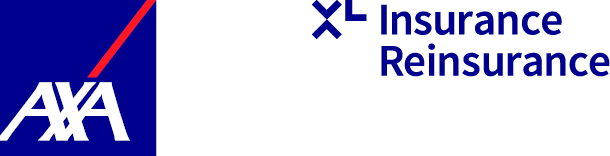Assurer l’immatériel
16 janvier 2019
Des actifs de valeurs, des risques spécifiques, des solutions sur mesure
Qu’il s’agisse d’algorithmes exclusifs, d’ensemble de données ou de chaînes logistiques complexes –pour ne citer que ceux-ci–, les actifs immatériels sont des facteurs de compétitivité et de profitabilité d’importance critique pour nombre d’entreprises. Selon une étude sur le sujet, ces actifs –qui incluent, entre autre, la marque d’une société, sa propriété intellectuelle et ses données– représentaient en 2015 plus de 85% de la valeur du S&P 500.
Tout comme les actifs physiques, ils doivent être protégés. Cependant, gérer et minimiser les risques qui leur sont associés est pour le moins difficile en ce qu’ils sont, par définition, indistincts. Leur valeur est subjective et souvent calculée par le biais de formules reposant sur des estimations des revenus qu’ils seront susceptibles de générer, dans le futur. Leur valeur est susceptible de varier grandement, même à court terme ; les menaces auxquels ces actifs sont confrontés ne sont pas toujours apparentes ni identifiables, et leurs impacts souvent difficiles à anticiper. Si, par exemple, le concurrent d’un acteur de la grande distribution copie son système de gestion des achats, l’entreprise pourrait perdre l’un de ses avantages concurrentiels les plus importants. Il est en revanche difficile de comprendre et d’estimer, en amont d’un tel événement, quelle incidence ce dernier aurait sur les ventes ou la profitabilité de l’entreprise.
De la même manière, lorsque l’un des systèmes d’une société est la cible de cybercriminels et que ses données sont compromises, la sévérité d’une telle attaque peut varier considérablement. Au mieux, les dommages se limitent au paiement d’une rançon, en échange des données subtilisées. Au pire, l’attaque est médiatisée, la réputation et la marque de l’entreprise sont sérieusement endommagées, faisant ainsi chuter ses revenus.
Une solution flexible, adaptable et dont l’impact en termes de fonds propres est limité
Les options disponibles pour couvrir les risques associés à la propriété intellectuelle, aux données, à la marque et à tout autre actif immatériel sont limitées.
C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’entreprises utilisent leurs captives pour mettre en place des solutions innovantes leur permettant de protéger leurs actifs immatériels contre les différentes menaces évoquées précédemment. Ils reconnaissent que la captive offre une alternative flexible, adaptable et ayant un impact limité en termes de fonds propres, à même de protéger leur réputation, leur propriété intellectuelle, leurs données et l’ensemble des ressources qui leur sont associées.
Tout comme les actifs physiques, les actifs immatériels doivent être protégés. Cependant, gérer et minimiser les risques qui leur sont associés est pour le moins difficile en ce qu’ils sont, par définition, indistincts.
Les options de transfert des risques associés aux actifs immatériels sont limitées, en partie à cause de leur historique insuffisant, ainsi que de leur nature intrinsèquement imprédictible. Une captive peut permettre de surmonter ces obstacles en groupant des risques volatils, pour lesquels les données sont limitées –comme les expositions liées à la chaîne logistique ou à la propriété intellectuelle– et des risques plus stables pour lesquels les risk managers disposent d’un historique de sinistres.
Ce processus permet ainsi de rendre un risque complexe assurable en l’agrégeant avec d’autres périls plus traditionnels. Certains assureurs ou réassureurs peuvent ensuite être prêts à accompagner ce type de programme, en particulier lorsqu’ils font partie de contrats multi-branches/multi-années, soutenus par de la réassurance structurée.
Cette approche comporte plusieurs avantages
D’abord, cela dote l’actionnaire d’une captive d’un mécanisme lui permettant de collecter plus d’informations sur les risques concernés. Ces données peuvent alors être utilisées pour améliorer les efforts de gestion du risque de l’entreprise en mettant en exergue les vulnérabilités liées, par exemple, aux opérations d’achats et de logistiques, ou aux systèmes de protection des données.
Cela peut également aider la captive et son assureur partenaire à affiner les termes, les conditions et les limites liées à la couverture de ces risques.
L’utilisation d’une captive permet également une réponse plus rapide et plus efficace. Dans de nombreux cas, lorsqu’un événement affecte un actif immatériel, il convient d’agir rapidement. C’est en particulier le cas lorsque la réputation d’une entreprise est en jeu. Lorsqu’un événement déclenche une vague de publicité néfaste, une couverture via une captive permet à l’entreprise de faire intervenir, rapidement, des experts en gestion de crise pour limiter l’impact et la durée de l’incident.
Enfin, au regard des nouvelles règlementations et des exigences de plus en plus strictes des gouvernements, utiliser une captive pour ne couvrir qu’une poignée de risques peut être considéré comme moins pertinent. Et à l’heure où les entreprises voient leurs ressources immatérielles se développer considérablement, les propriétaires de captives vont continuer à chercher des solutions innovantes pour couvrir leurs actifs jusqu’à présent non-assurables en réduisant la volatilité de leurs expositions dans leur ensemble et en améliorant leur utilisation de leurs fonds propres.
Marine Charbonnier dirige l’équipe Global Programs & Captives pour l’Europe. Elle intervient également sur le marché du transfert de risque alternatif depuis 1992. Elle est basée à Paris et peut être contactée à marine.charbonnier@axaxl.com.
Plus d’articles
- Par Risque
- Par famille de produits
- Par région
Liens directs
Ressources associées
- Tout afficher


Propulsion nucléaire : une voie stratégique vers la neutralité carbone du transport maritime

Assurance cyber : Que s’est-il passé en 2018 ?
AXA XL, en tant que régulateur, utilise des cookies pour fournir ses services, améliorer l'expérience utilisateur, mesurer l'engagement de l'audience et interagir avec les comptes de réseaux sociaux des utilisateurs, entre autres. Certains de ces cookies sont facultatifs et nous ne les installerons pas à moins que vous ne les activiez en cliquant sur le bouton "ACCEPTER TOUT". Vous pouvez désactiver ces cookies à tout moment via la section "Comment gérer vos paramètres de cookies" de notre politique en matière de cookies.